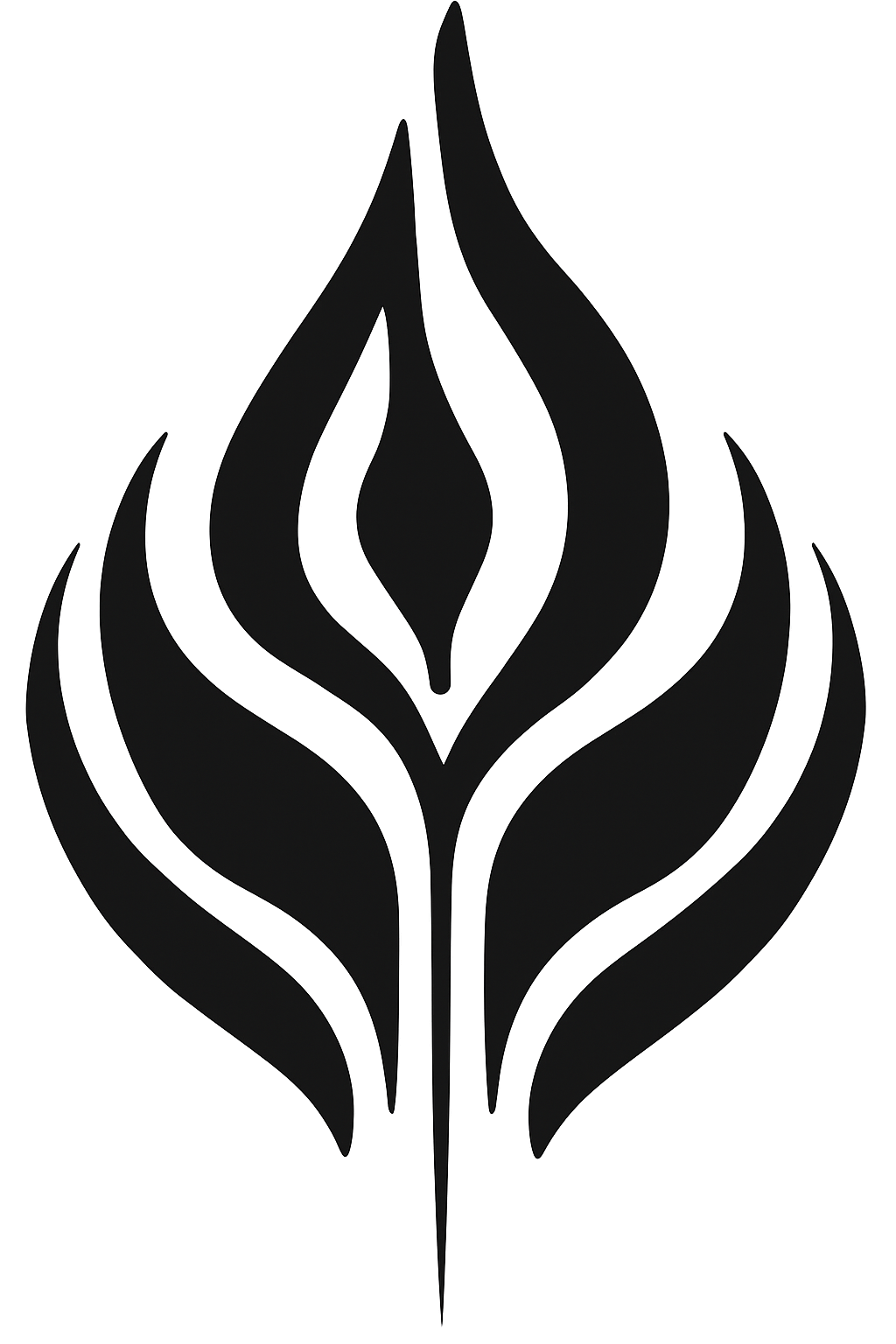S’expatrier ; se perdre ou se retrouver ?
Je me suis souvent interrogée sur ce que signifie être stable.
On entend parfois que les personnes nomades manquent d’ancrage :
« Tu ne te fatigues pas à toujours bouger ? »,
« Tu n’as pas envie, un jour, de te poser ? ».
Ces questions, souvent bienveillantes, traduisent une idée très répandue : celle que la stabilité se trouve dans l’immobilité. Pourtant, le mouvement n’est pas forcément son contraire.
Au fil de mes expériences, j’ai découvert que la perte de repères peut devenir un moteur de connaissance de soi — un passage parfois inconfortable, mais fécond, vers une forme de stabilité plus profonde.
Voyager, s’expatrier, se déplacer… autant de manières d’aller à la rencontre du monde, mais aussi de soi-même.
Si la stabilité ne réside pas dans un lieu, alors où s’ancre-t-elle ? Et en quoi pouvons-nous réellement nous enraciner ?
Perdre ses repères : quand notre monde vacille
Quitter un lieu, c’est souvent bien plus qu’un simple changement de décor. C’est laisser derrière soi des repères familiers, des visages, une langue parfois. Dans le tumulte de l’expatriation, il arrive qu’on se sente désorienté — comme si tout ce qui faisait notre équilibre se dissolvait dans un quotidien encore étranger.
Je me souviens de ma toute première matinée seule à Bombay, dans cet hostel.
Je n’avais aucune envie de quitter ma chambre.
Dehors, m’attendaient le bruit, une langue inconnue, des regards inhabituels… L’extérieur était source d’une inquiétante étrangeté. Comment me repérer dans cette ville qui bouillonne de toutes parts ?
Même les gestes les plus simples, comme faire ses courses, peuvent devenir une véritable épreuve.
Je me souviens de ma première journée à Beyrouth : je voulais simplement acheter du fromage blanc pour mon petit-déjeuner, mais rien ne semblait y ressembler dans la supérette du coin. Jusqu’à ce que je tombe sur le Labneh. Ni une ni deux, je le glisse dans mon panier, accompagné d’un paquet de céréales sucrées.
Arrivée à la caisse, je demande en montrant le pot :
— « Est-ce que ça convient avec les céréales ? »
Je vois alors mon interlocuteur me regarder avec une certaine perplexité :
— « Euh… pourquoi pas essayer ? »
Le lendemain matin, j’ai compris : le Labneh est un fromage salé, délicieux mezze, parfait pour l’apéro… mais bien moins adapté aux céréales au chocolat ! Quelques jours plus tard, je découvrais enfin, avec joie, le Laban, bien plus proche de mon fameux fromage blanc. Ces petits décalages du quotidien rappellent à quel point nos repères culturels sont profondément ancrés. Ce sont souvent eux, plus que les grands bouleversements, qui nous confrontent à la nouveauté — et qui nous obligent à nous réinventer, un pas (et une cuillerée) à la fois.
« Qu’est-ce que je fais là ? Pourquoi suis-je venue ? »
Dans ce sentiment d’irréalité, surgissent parfois des questions plus profondes :
Qui suis-je, au sein de ce monde ?
Loin de tout, on peut avoir l’impression d’être incognito — de pouvoir être qui l’on veut, recommencer à zéro. Combien de personnes ai-je croisées en voyage, aux histoires aussi loufoques qu’extraordinaires, à la fois lumineuses et cabossées par la vie… Qui étaient-elles avant cette rencontre ? Avant ce départ ?
Il y a, dans le voyage, un sentiment de liberté presque enivrant.
Même au sein de pays aux règles plus strictes, cette liberté semble s’imposer, comme une évidence. Peut-être est-ce parce qu’on est loin de chez soi, parce qu’on se sent invincible, à tort persuadé que rien ne pourrait nous arriver ?
Ou peut-être est-ce lié à cette identité vacillante, rendue souple par la perte de nos repères habituels — cette sensation d’être à la fois plus vulnérable et plus vivant que jamais.
Souvent, j’ai eu cette impression d’être entourée de personnes en errance, cherchant à se (re)trouver — et je me suis demandé si je n’étais pas, moi aussi, de celles-là. Pourquoi ai-je ce besoin de partir ?
En Guyane, les Français venus de l’hexagone sont souvent perçus comme des personnes qui cherchent à fuir quelque chose. Et il est vrai que, pour venir jusqu’ici, sur ce territoire si isolé, il faut sans doute avoir besoin de s’éloigner — des autres, du quotidien, parfois de soi-même.
Aujourd’hui, après toutes ces expériences et ces interrogations, je crois que c’est justement dans ce flou que quelque chose d’essentiel se révèle.
Loin de nos habitudes et de nos certitudes, nous apprenons à nous redéfinir.
À comprendre ce qui, en nous, demeure malgré le changement. Peu à peu, tout prend sens. On s’adapte, on s’intègre, on crée de nouveaux repères.
Et peut-être, au fil du chemin, on finit par se rencontrer à nouveau.
Apprendre à se rencontrer autrement
« Se perdre », c’est aussi s’offrir la possibilité de se redécouvrir.
Être confronté à d’autres cultures, d’autres façons de penser, c’est aussi questionner nos propres valeurs, nos croyances, nos certitudes.
Au Liban, une question revenait souvent : « Tu es de quelle religion ? »
En France, cette interrogation est presque taboue. Sur le moment, je me suis sentie un peu déstabilisée : suis-je religieuse ? ai-je la foi ? En quoi ce rapport à la religion peut me définir ?
Ce déracinement, cette rencontre avec l’altérité, met en lumière des parts de nous que l’on ne questionne jamais vraiment. C’est un terrain fertile pour mieux se connaître, au-delà des évidences.
On découvre parfois que l’on est plus sociable qu’on ne le pensait, plus ouvert, plus curieux.
Dans un environnement familier, entouré de nos repères et de nos amis, il est rare de faire le premier pas vers l’autre. Ailleurs, quand tout est à réinventer, ce pas devient presque vital — et souvent, il nous fait du bien.
Voyager, c’est aussi réapprendre à s’écouter.
Nos intuitions, nos émotions, nos besoins se font plus clairs lorsque tout le reste vacille. On redéfinit alors nos repères, on identifie ce qui nous apaise, ce qui nous nourrit.
Cela peut passer par des choses très simples : un bol de fromage blanc au petit matin, un thé chaud, une marche quotidienne, un moment de silence. Ces petits rituels deviennent nos points d’ancrage. Ils nous rappellent que la stabilité ne dépend pas d’un lieu fixe, mais de notre capacité à habiter pleinement le moment présent, où que nous soyons.
Mais lorsque l’on perd ce lien à soi, lorsque l’on cesse de s’écouter, le voyage peut effectivement devenir une fuite plutôt qu’une rencontre. Sans ancrage intérieur, on peut s’épuiser à chercher ailleurs ce qui, en réalité, se construit à l’intérieur.
Ce sentiment de liberté exacerbé que l’on peut ressentir peut alors devenir ambivalent — à la fois grisant et déstabilisant.
Il peut effrayer, ou au contraire mener à une vie « hors cadre », « hors limite ». Certaines personnes finissent par se sentir encore plus seules et déracinées malgré la beauté des paysages traversés. C’est pourquoi apprendre à reconnaître ses besoins, à s’écouter et à s’ancrer, même loin, devient essentiel pour ne pas se perdre complètement en route.
Habiter le monde
Au fil du temps, quelque chose se transforme. Ce qui paraissait étranger devient familier, ce qui inquiétait autrefois se fond peu à peu dans le décor du quotidien. Le labneh devient notre meilleur ami — et nos mésaventures culinaires d’hier nous font désormais sourire.
On s’étonne même parfois de notre progression.
On apprend à faire confiance au mouvement, à la vie telle qu’elle vient.
La stabilité n’est plus une question de lieu, mais de présence à soi.
On découvre qu’on peut se sentir « chez soi » dans une cuisine partagée, sur une terrasse inconnue, ou dans un regard bienveillant.
Ce sentiment d’appartenance n’a plus besoin de racines géographiques : il se construit à l’intérieur, dans la façon dont on se relie au monde.
Et quand on rentre — ou que l’on repart —, on comprend que l’ancrage ne se perd pas. Il voyage avec nous.
Il se tisse dans nos gestes, nos rituels, notre manière d’être au monde.
C’est peut-être cela : accepter de ne pas tout maîtriser, mais savoir que, partout, quelque chose en nous sait comment rester debout. Cette connaissance de nous même évolue, bien sûr, au fil des prochains départs vers l’inconnu.
N’oublions pas que notre identité est un processus, en constante transformation — rien n’est jamais figé - et je pense profondément que, se perdre, parfois, permet une telle transformation.
Au fond, peut-être que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de pouvoir partir à tout moment, mais dans la capacité à se sentir libre, où que l’on soit.
Libre de penser, d’aimer, de créer du sens.
Libre d’habiter pleinement sa vie, même quand elle ne ressemble pas à ce que l’on avait imaginé.
Cette forme de liberté naît justement de l’ancrage : quand on cesse de chercher ailleurs ce que l’on porte déjà en soi.
Voyager, rester, repartir… tout cela devient alors une question de mouvement intérieur, non plus une fuite, mais un choix.
Ainsi, peut-être que se perdre n’est pas le contraire de se trouver.
Peut-être est-ce une étape nécessaire : celle où l’on découvre que la stabilité n’est pas un lieu, mais une manière d’habiter le monde — où que l’on soit.